
OUVERTES À
LETTRES
Vertige de l’action
Seconde lettre ouverte à Romaric Sangars
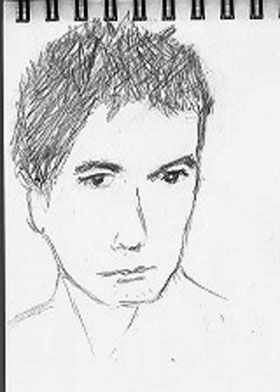 Cher Cosaque,
Cher Cosaque,
Nous nous sommes déjà entretenus, dans une précédente correspondance, de notre commune prétention à éradiquer le Bellâtre au verbe creux pléiadisé. Je vous écris, cette fois-ci, au sujet de votre premier roman récemment paru.
Et il me faut vous dire, là, tout de suite, d’entrée de jeu, que votre texte est globalement… mauvais. N’allez pas de ce pas vous méprendre sur le qualificatif, qui ne disqualifie votre prime tentative de jeune romancier que sur un plan moral : j’entends « mauvais », ici, au sens de « malsain ». Votre livre est contraire à son but : il n’élève pas vos Verticaux, les malheureux restant à l’horizontale de leurs aspirations, certes élevées. La faute en incombe à une grande tristesse, dont l’époque dresse la potence dépressive au cœur même de nos vies. Vous n’avez pas su vous départir de cette tristesse, et elle déporte avec elle vos personnages… La désespérance maintient son régime d’acédie, teintant même les tentatives d’héroïsme d’un dégoût pour l’action entreprise in fine. C’est catastrophique.
Se dépouiller pour le Royaume est toujours une opération périlleuse, l’acédie se nourrissant en nous aussi de nos efforts pour conquérir l’Absolu. Au prix trop cher payé des renoncements, il ne reste qu’une terre brûlée, où seule l’élection est réservée aux êtres calcinés. Cette forme de barbecue spirituel est insoutenable… Vos Verticaux feront donc l’expérience d’une quête à rebours de leurs idéaux. Ils seront victimes du défi qu’ils auront lancé à leur désenchantement, le mal n’ayant jamais été dans l’extériorité, espace où l’opposition peut se résoudre par l’action, mais dans l’intériorité, en eux, là où la tristesse sévit et la fuite trompe sur les perspectives… Lia explique cela très bien à Vincent lorsqu’il interroge cette dernière sur les véritables motivations d’Emmanuel, qui, selon la pythie du roman, s’est laissé blesser par un amour déçu afin de se rendre libre pour un accomplissement plus haut. Et ce sera, en définitive, une chute… car son aspiration, dès le départ, était à la perte, orientée vers la destruction, non pas théologique, mais téléologique.
On peut donc établir, pour rendre un peu mieux justice à votre tentative romanesque, que vous avez voulu réhabiliter, en des termes fatals, la Tragédie. Du reste, instinctivement, et c’est mon petit côté Lia, j’ai rangé votre roman sur une étagère nouvellement ouverte pour recevoir de nouveaux livres : vous êtes le second auteur à y être accueilli, à côté de MBK, lui-même édité chez Léo Scheer. MBK, c’est Mehdi Belhaj Kacem, et le titre de son livre que côtoie le vôtre est : Algèbre de la Tragédie ! Le lien est doublement évident pour moi : même éditeur, même thématique. Mais MBK attaque le sujet sous l’angle de la philosophie tandis que vous lui prêtez les reliefs de la fiction. Cependant, tous les deux, vous en venez à dresser le constat de l’impossibilité du tragique, qui, paradoxalement, serait la forme la plus aboutie de la tragédie de l’existence :
« Le fait [est] que la condition moderne n’est plus le Tragique proprement dit, mais le pathétique. [L’homme moderne] ne meurt pas biologiquement, il meurt à la vie. Sa Tragédie est « plus puissante » que celle d’Antigone, parce qu’elle est d’ores et déjà pathétique. […] On le voit avec le théâtre contemporain : même s’il joue des « tragédies », il est un théâtre du pathétique, qui est quelque chose que nous dirons, par provision, l’impossibilité du tragique. Nous voyons donc que la question de « l’homme moderne », celui des massacres de masse et de la technique […] est celle de ce lien entre l’esthétique comme production positive du Mal, depuis Sade, et du pathétique venant en lieu et place de la Tragédie. On le voit encore avec l’arithmétique du sarcasme qui définit une large part de la production d’art contemporain au sens étroit. On le voit plus nettement encore avec la littérature « dépressionniste » du nihilisme démocratique français : tendant à celui-ci son miroir, on a à la fois une objectivation de la déréliction de l’homme extradé de son monde par la technique, et donc un « cynisme réaliste », une espèce de cruauté sans délectation (de « sadisme » achevé, comme on a vu, c’est-à-dire psychofrigide et/ou impuissant), et d’un autre côté une sorte de conjonctivite compassionnelle continue. Méchanceté atone et sensiblerie aphone » (Mehdi Belhaj Kacem, Algèbre de la Tragédie, éd. Léo Scheer, 2014).
Cher Cosaque, votre roman parvient-il à lever cette malédiction ? Je laisse le lecteur juge.
Second rapprochement, annonçais-je, entre vous et MBK, l’éditeur : or, c’est une énorme surprise. Pourquoi n’avoir pas confié votre texte à Pierre-Guillaume de Roux, qui avait précédemment pris en charge votre retentissante gifle au vieux débris hybride d’ineptie et de snobisme en perfusion sous la Coupole ? Car enfin, Léo Scheer, c’est…
Tenez, pour l’anecdote risible et détestable à la fois, je vous livre le souvenir de mes premiers pas chez Léo, à l’adresse de sa Maison, rue de l’Arcade à Paris, pour une conférence/débat en soutien à Gabriel Matzneff et, plus largement, contre le retour à « l’Ordre moral ». Nous étions sous le règne de Chirackam le Rouge et moi en année d’Hypokhâgne. Je tenais l’occasion d’être présente à ces agapes de résistants pédophiles par le biais d’un ami, Julien, expressément invité là par Emmanuel Pierrat, lui-même Maître de cérémonie, avec pour adjoint « l’homme qui valait 99 F ». Au bras de Julien, je devais passer pour une Lolita appréciable si j’en juge par les coups d’œil approbateurs que nous jetèrent à plusieurs reprises certains invités, dont l’homme à 5,90 € en poche. Mais recadrons le débat : Léo offrait le gîte, le buffet, frugal, et une salle pour lire, haut et fort, en exclusivité, des extraits du dernier tome du Journal de Gabi paru cher Scheer, évidemment. Dans une pièce étriquée, attenante à l’auditorium improvisé dans le hall, un petit musée, relevant du reliquaire, offrait à notre vénération des objets ayant pour objet l’heureux diariste : il y avait à voir des photos de son défilé chez Kenzo comme mannequin chauve et sans chaussettes dans ses mocassins vernis ; puis à découvrir en aperçu en vitrine des calepins en moleskine de sa prose, baiseuse immodeste ; il y avait même, à renifler, une chemise, dans le style de celles de BHL, immaculée, il va sans dire, encore tout imprégnée du parfum suave du bourreau victime de ses victimes – ô sein de Gabriel, apitoyez-nous sur votre sort !
« Nous savons grâce à monsieur Matzneff à quoi rêvent les jeunes filles. À périr de jouissance dans les bras des messieurs faits. Il nous explique le mal qu’il a, à ne pas succomber à toutes les tentatives de détournement de majeur dont il est victime de la part des jouvencelles. Des vraies furies lubriques qui le harcèlent de leurs désirs et de leur correspondance polissonne. Heureusement pour elles, les moins de seize ans, c’est son plat préféré à ce bon chrétien orthodoxe. Après, c’est foutu, les filles ont la choune qui pue la femme rance, et les garçons, qui ressemblent tant à des filles avant cet âge (ah bon ?) se mettent à empester le bouc. Pouah ! C’en est fini, des amours bleues et roses, et il faut chercher d’autres tendresses » (Gérard Zwang, Lettre ouverte au mal baisants, 1975).
Tout ce parterre de salauds tremblait pour son petit cul, chacun comptant bien sur cette communauté d’abjections pour y puiser sa propre immunité ; il s’agissait là d’établir un front inique pour préserver son unique droit à une nique très « personnelle ». Je ne me rappelle pas très bien ce qui justifiait leur crainte d’un retour à l’Ordre moral qui eût impliqué leur castration chimique immédiate ? Toujours est-il que la méchanceté de ces hommes fut à mes yeux balayée par un ridicule dont le grotesque culmina avec l’arrivée d’Henry Chapier, très en retard, appuyé sur un « bâton de Jacob » imberbe et hébété, auquel il enjoignit de le guider à travers la foule, par définition hostile, jusqu’à une place digne d’accueillir son glorieux séant. Il fallait voir le regard furibard du grand décadent aux blancs cheveux hystériques eux aussi ! Au final, ce fut moi qu’il dégagea de « sa » place, menaçant de me faire mordre par son éphèbe douteux. Je lui concédais volontiers la politesse due aux vieux messieurs, ce qui ne manqua pas de le froisser dans son vitalisme obscène. J’en ris encore…
Et c’est surtout cela qui manque à votre livre : de l’humour, cher Cosaque ! Il faut savoir manier l’esprit du « Gay savoir » lorsque l’on fraye parmi Sodome, non ?
Vos héros ont l’héroïsme trop servile. Leur propension aux addictions alcoolisées ou tabagiques ne leur laisse pas non plus beaucoup de liberté. Car, sur le fond de l’époque, disons-le franchement, c’est la soumission aux toxiques et non celle islamique qui nous ruine ! Je n’ai jamais lu autant boire que dans votre livre, qui compte plus de « cadavres » que l’Adieu aux armes d’Hemingway ! La drogue ainsi va du Black velvet avec Loreley au Cercueil (cocktail requérant le mélange de tous les alcools présents au bar). L’alcoolisme mine de la première à la dernière ligne l’orientation psychologique de vos personnages. Quels déboires, ensuite ! Leur trajectoire ne saurait être droite tant imbibée...
Et le sexe, comme l’alcool, est triste aussi… Je vous le disais, c’est un fond de désespoir qui traverse toute l’histoire, maladie d’âme de laquelle aucun de vos protagonistes ne triomphe.
Enfin, comme Breton, vous abandonnez votre Nadja, tandis que vous notez parfaitement l’origine en Occident du terrorisme en tirant (au double sens du mot) du Manifeste de 1923 la phrase de l’absolu radicalisme qui va déclarant, à tire-larigot, qu’il n’y a rien de plus génialement surréel que de sortir de chez soi armé d’un pistolet et de le décharger au hasard sur la foule. Ite missa est !
Avant d’incriminer je ne sais quel Vieux sur la Montagne d’Orient, commençons, à juste titre, par faire le ménage parmi les histrions de nos écoles de pensée, et butons Breton, comme lui-même buta France ! « Ah ça Tzara, ça Tzara, tous les Dadas à la lanterne ! » La vraie révolution, commençons par la faire chez nous en nous. Et tenons ici une révélation : pour combattre en nous le mal, nous n’avons pas besoin d’armes physiques…
Vous dites que votre héros « caressait sceptique la courbe de son katana » ; je comprends bien qu’il ne sache plus comment s’en servir ? Les Samouraïs, depuis des lustres, sont foutus, rasibus, décalqués momies au sanatorium d’Hiroshima. Définitivement, l’honneur a disparu à la guerre avec l’apparition de la bombe H. Déjà, du fond médiéval, l’arbalète avait changé la donne, aussitôt condamnée à l’époque par l’Église, qui comptait toujours circonscrire l’art de la guerre dans le cadre d’un honnête duel. Insidieusement, le « Vieux Charles » a viré « Enola Gay ». Nul ne peut prétendre maîtriser le « progrès » technique… qui est ontologiquement nazi ; Heidegger l’avait bien saisi, lui qui tâta des deux philosophiquement. Nous voilà prévenus.
J’abandonne ici, hélas, mon propre sabre japonais à « la nostalgie des magies mortes », comme vous les appelez. Votre livre vient de me déterminer à délaisser définitivement la « Voie du sabre ». Mon modèle de l’ère Tokugawa sera prochainement déposé pour un don au musée Guimet, où des spécialistes en « chinoiseries », n’en doutons pas, sauront identifier très exactement le tsuba pour en dater l’histoire.
Au fil de cette lettre, ne manquez pas, cher Cosaque, si elle ne vous laisse pas trop déconfit, d’y ajouter l’expression de la réponse que vous souhaiteriez lui donner.
C’est une Hauteclaire Stassin repentie qui vous salue, lame brisée.
Alexandra Lampol-Tissot
PS : Il y a une jeunesse, une genèse à l’œuvre…
© Hypallage Editions – 2016
………………
Réponse de Romaric Sangars
Chère Alexandra-Hauteclaire,
Merci d’avoir pris la peine de formuler ainsi l’écho de votre lecture, lequel, pour l’auteur du texte, ne manque jamais d’intérêt, quelle que soit l’appréciation que cet écho véhicule. Je n’ai malheureusement pas le loisir de vous répondre aussi longuement que je le voudrais, mais voici, cependant, ce que je peux vous dire au sujet de vos diverses remarques. Sur le fait que mon roman serait « moralement, mauvais », je vous répliquerai qu’un tel jugement n’a, d’un point de vue critique, strictement aucune signification. « Un livre n’est ni moral ni immoral, il est bien ou mal écrit », disait Wilde. Cependant, que vous affirmiez cela traduit bien quelque chose comme votre déception quant à la trajectoire de mes personnages au vu de leurs aspirations, et c’est, je pense, ce que vous voulez exprimer par là. C’est pourtant, sans que je prétende comparer mon livre à ces grandes œuvres, l’impression que livre également la lecture du Rouge et le Noir ou celle de Madame Bovary. Mes personnages ratent, du moins en grande partie, mais ce ratage est plus intéressant et plus romanesque, également, que la réussite un peu béate que donnerait un récit d’édification, parce qu’il expose, entre autres, la problématique incarnée. J’aime qu’un roman aspire et révèle l’atmosphère d’une époque. Cette atmosphère est « mauvaise ». Il est donc naturel que mon livre vous paraisse ainsi, qu’il vous paraisse sombre. Je n’ai pas voulu me « départir de cette tristesse » comme vous le dites, j’ai précisément souhaité l’exprimer. Mes Verticaux se trouvent être nés dans une époque contraire en tout point à leurs aspirations. L’analyse de Lia, que vous citez, sur l’élan d’Emmanuel, n’est nullement exclusive. Est-ce une fuite ou un essor ? Pour ma part, je crois que les deux explications peuvent coexister, parce que l’incarnation est impure, mêlée, paradoxale, contrairement aux réalités abstraites qui concernent le catéchisme ou l’essai ou la philosophie, mais pas l’art, pas la création, qui compose avec la chair des choses et du monde.
Je suis ravi que mon livre côtoie celui de MBK ; je ne sais s’il lève la malédiction que vous évoquez à travers les analyses de ce dernier, mais ce qui est certain, c’est justement que mes personnages, aussi cramés soient-ils, incarnent des types à rebours de la plupart des personnages de romans français depuis trente ans. Ils ne sont ni atones, ni médiocres, ni cyniques, ni purement dépressifs, ni obstinément narcissiques. Et c’est bien ça qui les consume.
Votre anecdote sur cette soirée de défense de Matzneff chez Léo Scheer est amusante, mais assez hors sujet pour ce qui regarde directement mon livre en tant que tel. Je me souviens d’ailleurs m’être rendu à une soirée qui ressemble à celle que vous décrivez, mais la mienne se déroulait rue de Verneuil, dans l’ancienne galerie de Léo Scheer, non aux éditions. Je trouve au contraire de ce que vous dites qu’il y a une importante dimension comique dans mon roman, et c’est d’ailleurs une remarque qu’on me fait très régulièrement. Après, l’humour est quelque chose de très personnel et il est possible que vous n’ayez pas été sensible au mien. L’emploi de mon narrateur comme intervieweur de célébrités donne lieu à de nombreux passages satyriques et, par ailleurs, le ton qui est le sien est généralement empreint d’une espèce d’ironie amère, laquelle ne prétend certes pas susciter l’hilarité, mais allège et nuance son spleen d’un regard amusé.
Au sujet de l’imbibition éthylique de mes personnages, disons que ne sélectionnant mes fréquentations que parmi un vivier d’alcooliques garantis, j’ai peut-être quelques difficultés à évaluer la surdose. Mais notez que cette omniprésence de l’alcool possède une résonance symbolique essentielle. S’il faut être ivre, toujours ivre, ainsi que le préconisait l’incontestable Charles, et qu’il y a pénurie de poésie et de vertu… Non, mais sérieusement, ce qu’ils recherchent tous trois, Vincent, Emmanuel et Lia, chacun à leur manière, tient à l’ivresse supérieure, spirituelle, légendaire, artistique, et le monde moderne se montrant désespérément sobre sur ces plans, l’alcool s’impose comme palliatif et révèle paradoxalement le dégrisement fondamental de l’époque. Encore une fois, ça n’a aucun sens, selon moi, d’en conclure que c’est mauvais pour la santé de mes personnages et pour leur élévation spirituelle, il ne s’agit pas de montrer méthodiquement comment on s’élève, il s’agit d’exposer comment ça souffre et comment malgré tout quelque chose continue de brûler.
Sur Breton, je vous trouve sévère. Évidemment qu’il y a quelque chose de précaire, de simpliste et de daté dans la manière dont les surréalistes ont perçu le monde et pratiqué la poésie. Il n’empêche, même si « pas jusqu’au bout », ces poètes prenaient au sérieux la Providence et les fulgurances et l’innervation de l’Esprit, quoi qu’ils traduisissent tout ça dans un jargon freudo-animiste aujourd’hui périmé, et ils prenaient cela au sérieux au moment même où la plupart des gens d’Église eux-mêmes ne le prenaient plus au sérieux et progressaient déjà vers la dissolution de tout mystère en moraline.
Quant au Progrès qui serait ontologiquement nazi, non, c’est un tigre à chevaucher qui s’est sans doute fait dragon. Mais il s’agit là encore de théories générales, ce n’est pas la question que pose mon roman. Il se situe sur le plan des personnages et donc de l’incarnation, encore une fois. Le problème d’un Emmanuel Starck, c’est de trouver un moyen de redresser un certain instinct héroïque dans un climat évidemment contraire, un instinct dont il ne va pas faire le deuil parce qu’on viendrait lui expliquer que la modernité technique l’invalide. Il va se confronter à cette difficulté. La voie qu’il prend n’est pas celle que je préconiserais ou que je ne préconiserais pas, mais elle le montre aux prises avec toutes ces dimensions contradictoires.
En définitive, vos réflexions sont intéressantes, chère Alexandra, mais elles visent à côté en termes de critique d’une œuvre de création, elles semblent plutôt un prolongement des pensées et des révoltes que mon roman a pu susciter en vous, ce qui, dans tous les cas, prouve que vous m’avez lu avec attention et que vous vous êtes investie émotionnellement dans cette lecture, celle-ci vous laissât-elle des impressions négatives, ce pourquoi je vous suis quoi qu’il en soit reconnaissant d’un tel effort, et je vais, de ce pas, descendre une bouteille de Gin à votre santé.
Quant à votre sabre, ne vous précipitez pas pour le revendre, mettez-le seulement au grenier pour l’heure. On ne sait jamais, une soudaine envie de trancher quelque chose est si vite revenue.
Bien à vous,
Romaric Sangars